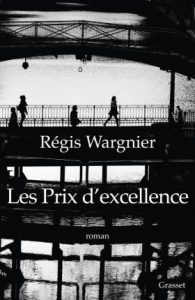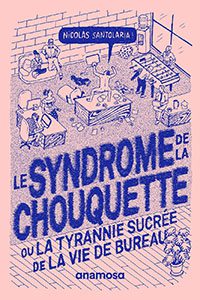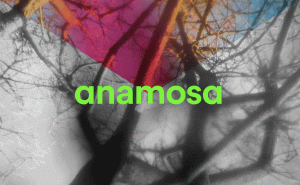Portfolio Categories : Chocs !
11 L’odeur de la déesse Canne

La bouteille est dans la cave, bien fermée. Je sais qu’un jour je descendrai la chercher, je la sortirai de son sac plastique et je l’ouvrirai, laissant l’odeur de la substance qu’elle contient me frapper au visage. J’attends cette claque tout autant que je l’appréhende. Cette odeur est implacable. Lourde, chaude, elle est d’une intensité à couper au couteau, comme celle du pétrole brut. Elle n’offre aucune échappatoire, ne propose aucun cheminement, aucune interprétation. C’est un mur contre lequel on se cogne. C’est une odeur difficile à supporter, qui emprisonne et qui vous poursuit longtemps. Pendant plusieurs mois, elle s’est immiscée dans la racine de mes cheveux, dans les pores de ma peau, dans les fibres de mes vêtements. Aucun savonnage ne pouvait en venir à bout. J’ai dû jeter mes vêtements. Cette odeur est un mirage, un fantôme, une prison, une folie. Cette odeur, c’est celle de la mélasse de canne à sucre qui continue à flotter sur les usines désaffectées de l’arrière-pays cubain.
« Aujourd’hui, l’implacable déesse a abandonné
les azucareros, les ouvriers du sucre. »
En 2016, j’ai été le premier Occidental autorisé à me rendre dans les villages des centrales sucrières cubaines depuis 1960, et certainement le dernier depuis. Après de longs mois de négociations, j’ai obtenu le sésame du Ministère de la culture cubain, en sachant que j’étais dès lors surveillé 24h sur 24 par le régime, comme ma femme Olivia et nos deux enfants qui étaient alors à la crèche à La Havane. Alors que les touristes et les visiteurs officiels ne voient de Cuba que la version autorisée et instagrammable, j’ai pu pénétrer dans les zones de production de cannes à sucre qui ont fait la fierté du peuple cubain depuis le XVIe siècle. Il y a soixante ans, le dernier occidental à être venu ici n’était autre que Jean-Paul Sartre. Avec Simone de Beauvoir, ils avaient visité l’île dans la voiture de Fidel Castro, qui tenait à leur montrer la puissance sucrière du pays. Dans une série d’articles publiée dans France Soir, intitulée Ouragan sur le sucre, l’écrivain décrivit « l’implacable déesse canne » qui régnait sur le pays, une industrie oppressante pour laquelle le peuple était prêt à tout sacrifier par conviction idéologique.
Aujourd’hui, l’implacable déesse a abandonné les azucareros, les ouvriers du sucre. Après la chute du mur de Berlin, l’URSS a entrainé Cuba dans sa chute, cessant à la fois l’aide financière et les commandes de sucre, qui représentaient presque la totalité de la production nationale. Au début des années 2000, le gouvernement a dû fermer les trois quarts des sucreries : sur 156 usines, il n’en reste plus que 42 en état de fonctionnement, qui semblent pour la plupart tourner au ralenti. Mais dans un total déni de réalité, le gouvernement continue à contraindre des milliers d’ouvriers à rester dans les usines vides, fidèles au poste quoi qu’il advienne. Ils savent que les usines ne repartiront plus, que les cannes chétives ne produiront plus de sucre, mais ils sont condamnés à errer dans les bateyes, ces villages d’une pauvreté extrême qui jouxtent les centrales. Sans avenir, ces millions de Cubains vivent comme ils peuvent dans des logements de fortune, ressassant inlassablement leur passé agricole et révolutionnaire, comme pour mieux oublier que le temps s’est arrêté.
« Ils savent que les usines ne repartiront plus, que les cannes chétives ne produiront plus de sucre,
mais ils sont condamnés à errer dans ces bateyes«
En venant de La Havane, l’odeur des usines se fait palpable avant même que les fûts des cheminées n’apparaissent au bout de la piste. C’est l’odeur indescriptible de la mélasse de sucre, qui était chauffée dans les tuyaux pour produire le fameux sucre cubain. Je ne sais pas s’il reste des silos de mélasse stockée quelque part ou si des décennies de production sucrière ont imprégné l’air jusqu’à aujourd’hui, mais l’odeur des usines désaffectées a toujours un poids difficile à supporter. Il faut imaginer que des millions de Cubains vivent en permanence dans cette ambiance qui peut évoquer celle d’une raffinerie, mais dans laquelle on mettrait du sucre dans le pétrole. Cette odeur vient pourtant d’une autre époque, quand les usines tournaient à plein régime et que la mélasse brûlante devait embaumer toute l’île. Personne ne s’en plaint jamais, et on entend toujours la même rengaine : le sucre c’est la vie, la productivité, l’économie, l’histoire du peuple cubain, la force du pays…. Dans un paysage fantomatique, la déesse canne est devenue une odeur poisseuse et collante qui plane sur Cuba. Elle réconforte les âmes errantes et veille à les maintenir éternellement sous son joug.
De ce voyage est né un livre, Desmemoria, et une exposition de photographies, dont le vernissage a lieu ce soir. Ce travail anthropologique et artistique met en lumière la dissonance cognitive d’un pays dont l’idéologie s’effondre, et j’espère qu’il donnera à voir la réalité du peuple cubain au plus grand nombre. Mais pour faire ressentir pleinement aux visiteurs la réalité de ce pays figé à jamais dans une autre époque, j’espère qu’un jour je redescendrai à la cave et que j’emporterai la bouteille dans un lieu que je ne connais pas encore pour laisser l’implacable déesse sortir de sa bouteille…
Un récit de Pierre-Elie de Pibrac mis en mots par Sonia Buchard.
Pierre-Elie de Pibrac, photographe
Après de premiers reportages à Cuba et en Birmanie, Pierre-Elie de Pibrac remporte de nombreux prix et concours et assiste des photographes de renom avant de signer sa première série d’envergure en 2010 : American Showcase qui fait l’objet d’un livre publié par Archibooks. En 2012, il compose la série Real Life Super Heroes qui met en scène le célèbre phénomène américain des « super héros de la vraie vie ». Il expose en France et à l’étranger dans de nombreuses galeries, mais aussi au Grand Palais et dans de nombreuses foires internationales. En 2013-2014, Pierre-Elie suit les danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris. De ce travail qui se décline trois séries, sont nés un livre publié aux éditions Clémentine de la Feronnière et une série d’expositions à Paris, Los Angeles, Miami et La Havane : In Situ – Dans les coulisses de l’Opéra de Paris.
D’octobre 2016 à juin 2017, Pierre-Elie de Pibrac a vécu 8 mois en famille à Cuba pour y réaliser le projet Desmemoria, un témoignage sur la vie des Azucareros, un peuple issu du sucre, vivant pour le sucre et révolutionnaire de la première heure. A travers ce témoignage, Pierre-Elie ouvre une réflexion sur l’identité des Cubains. Il a remporté le Prix Levallois avec ce projet.
#7 Questionnaire olfactif de Régis Wargnier

Mondialement connu pour Indochine, son chef d’œuvre oscarisé, le cinéaste Régis Wargnier revient cette année sur la scène médiatique avec un premier roman étonnant, Les Prix d’Excellence chez Grasset. Créateur d’images virtuoses, l’écrivain-réalisateur se révèle aussi être hyper-sensible à l’univers des odeurs et des parfums. Petite interview olfactive d’un homme qui aurait aussi rêvé de devenir nez…
Une odeur qui vous rendait heureux enfant ?
Celle de l’Ambre solaire. C’était l’odeur de la plage en été, du soleil et des bains de mer. Je me vois à cinq ou six ans descendre par les remblais pour atteindre la plage de Carnac, dans le Morbihan. L’odeur huileuse et sucrée m’enveloppait avant même d’arriver sur le sable. Dans les années 1950, presque la moitié des baigneurs s’aspergeaient de cette huile au parfum de patchouli, introuvable aujourd’hui. Il suffit de prononcer son nom pour faire jaillir une myriade de souvenirs de grandes vacances. Et puis c’est un joli mot, « ambre », non ?
Une autre odeur de vacances ?
L’odeur de l’océan Atlantique. Celle d’un port de Bretagne, puissante, que l’on respire à plein poumons en arrivant de Paris. Elle annonce le début des vacances. J’aime les odeurs marines, elles me revitalisent. Je pense aussi à l’odeur unique de la thalassothérapie, qui nous fait basculer dans un autre univers dès la porte d’entrée. Je recommande celle de Quiberon, la pionnière et la meilleure.
Une odeur de voyage ?
L’odeur de l’Inde. Je l’ai découverte il y a longtemps, dans un souk de Bombay. C’est l’odeur de la cuisine et des épices, un puissant mélange de cardamome, de curry, de curcuma, de cumin, de coriandre fraîche et de menthe. Plus tard, je l’ai retrouvée dans une épicerie de la rue Montorgueil à Paris, où j’aimais aller humer les sacs de jute aux parfums d’Orient. Malheureusement cette caverne d’Ali Baba a fermé…
« On avait l’impression de manger la mer à chaque inspiration. »
Une odeur qui mérite le déplacement ?
Il y avait à Tokyo un marché aux poissons à l’odeur absolument hallucinante. Sur les bâches noires et luisantes s’étalait la chair rouge des thons aux côtés des poulpes et des calamars géants. Le spectacle était d’une puissance folle, mais j’ai toujours pensé que si je l’avais filmé, il aurait manqué l’odeur du sang de poisson, de l’iode et des algues. On avait l’impression de manger la mer à chaque inspiration. Il m’est arrivé de faire visiter ce lieu à des amis, mais je dois avouer que je me suis senti un peu seul dans mon délire olfactif !
Une odeur dérangeante ?
Celle de l’eau de javel et de la serpillère sale. Lors de mon premier voyage en URSS, juste après la chute du mur, je me suis senti poursuivi par deux odeurs entêtantes : celles des produits d’entretien bas de gamme et de l’essence frelatée. En 1997, pendant le tournage du film Est Ouest (avec Sandrine Bonnaire et Catherine Deneuve), ces odeurs sont restées omniprésentes dans tous les lieux où j’allais. Elles resteront toujours pour moi associée au film et à la Russie.
Une odeur rassurante ?
L’odeur des garages. Depuis que je suis tout petit, j’aime l’odeur de l’essence et de l’huile de moteur. Le garage est une univers olfactif fort et enveloppant. L’odeur crée la bulle. Je m’y sens bien.
Une odeur flash-back ?
Celle du charbon. Pendant le tournage des scènes finales d’Indochine, toute l’équipe du film était gênée par l’odeur des mines voisines, qui chargeaient l’air de poussières. Pour moi, cette odeur particulière avait le pouvoir de me transporter instantanément du Vietnam à l’appartement de mon enfance, chauffé au poêle à charbon. J’aimais accompagner mon père à la cave pour aller remplir le seau à la lueur de l’ampoule. Le charbon était noir, salissant, j’adorais.
« Le garage est une univers olfactif fort et enveloppant. L’odeur crée la bulle. »
Une odeur végétale ?
Je suis peu sensible aux parfums floraux, je commence juste à m’y intéresser depuis peu. En revanche j’adore l’odeur des sous-bois. J’aime me sentir englouti dans la fraîcheur des arbres lors d’une marche en forêt, lorsque la canopée masque le ciel et que l’odeur de la terre se mêle à celle des écorces et des arbres. J’aime cette sensation sauvage et puissante, protectrice. L’été, le parfum de la garrigue fait aussi partie de mes préférés, avec ses sillages de thym, de sauge et de romarin.
Une odeur du quotidien addictive ?
L’odeur de la cuisine à l’ail et à l’huile d’olive. Celle du repassage. Et celle de la cuisson du riz. J’adore l’odeur du rice-cooker, c’est celle des gens qui ont peu mais qui savent l’apprécier.
Quel parfum portez-vous ?
Je suis fidèle à New-York de Nicolaï. C’est un parfum boisé, qui sent le poivre, le citron, le clou de girofle… C’est peut-être une coquetterie mais j’aime porter un parfum que je suis sûr de ne pas sentir sur tout le monde, c’est un peu ma signature olfactive. J’aurais d’ailleurs aimé être nez, je me suis même entraîné à un certain moment.
Quels sont vos parfums préférés ?
Selon moi, Eau sauvage de Dior, Vétiver de Carven et Habit Rouge de Guerlain restent des parfums inégalables, bien supérieurs aux molécules actuelles. J’ai un souvenir ému de Vent Vert de Balmain, porté par une certaine Marianne rencontrée sur les quais de la Trinité-sur-Mer lorsque j’étais adolescent. Plus récemment, j’ai été troublé au Festival d’Arcachon par Pour un Homme de Caron, un accord lavande vanille original. J’aime aussi reconnaître les notes boisées de Féminité du bois et Chêne de Serge Lutens. Pendant l’enregistrement de la voix-off d’Indochine, je me souviens aussi que Catherine Deneuve m’avait offert L’ombre dans l’eau de Diptyque. J’ai aussi souvent offert des parfums à mes acteurs et mes actrices… De mémoire, j’ai dû choisir Coco de Chanel à Sabine Azema et Monsieur Chanel à André Dussolier. Mais qu’il y a-t-il de plus difficile que d’offrir un parfum ?
Propos recueillis par Sonia Buchard
Régis Wargnier, cinéaste et écrivain
Régis Wargnier a réalisé dix films pour le cinéma, dont Indochine (1991), avec Catherine Deneuve, qui a remporté un Oscar et cinq Césars. Il a également réalisé Une Femme Française (1995), avec Emmanuelle Béart, Est Ouest (1999) avec Catherine Deneuve et Sandrine Bonnaire, Man to Man (2005) avec Joseph Fiennes et Kristin Scott Thomas, Pars vite et reviens tard (2007) d’après le roman de Fred Vargas. Les Prix d’excellence est son premier roman.
Cette histoire vous est offerte par
Magdalena BEYER a été la pionnière des produits cosmétiques 100% frais et de parfums sans alcool. Avec fridge by yDe, elle propose des soins sans conservateur, ni substance synthétique, ni alcool, qui se démarquent par le concept innovant dans le respect absolu de la nature. Chaque soin se compose d’une quantité sans précédent de principes actifs et d’huiles essentielles aussi précieuses que le Néroli ou la Rosa canina. Grâce à Fridge, votre peau respire. Le nec plus ultra des cosmétiques bio.
Le coin shopping
Crédits photo : Pxhere
La Parenthèse Inspirée remercie The French Publicist, Conseil en RP 2.0 & Celebrity Marketing
#4 – Alerte sur la décharge

Les chiffres n’ont pas d’odeur. Faisons le test : « Huit millions de personnes meurent chaque année à cause de nos déchets ». Qui a la nausée ? «Le sixième continent, une soupe de plastiques flottant au milieu l’océan Pacifique Nord, mesure plus de trois millions de km2, soit plusieurs fois la superficie de la France.» Qui suffoque ? « Plus de 12500 espèces animales sont menacées de disparaître de la surface de la Terre ». Qui a un haut le cœur ? Aussi révoltants soient-ils, ces chiffres que nous connaissons tous ne suffisent pas à nous prendre aux tripes.
A chaque fois que je tente de convaincre mes interlocuteurs de l’absurdité de notre modèle linéaire actuel et de l’urgence absolue d’en changer, j’aimerais leur faire sentir la véritable odeur de notre système de production de déchets. Car elle est insoutenable. Avec Raphaël Masvigner, mon associé, nous l’avons sentie à Dakar, dans la décharge à ciel ouvert de Mbeusse. Elle a envahi nos narines et s’est infiltrée dans nos poumons jusqu’à mettre nos sens en alerte maximale. Cette odeur-là ne s’oublie jamais. C’est un électrochoc.
Dans le taxi qui nous mène au Nord-Est de la capitale sénégalaise ce matin de juillet 2015, rien ne nous prépare à une telle agression olfactive. On peut très bien visualiser une décharge, mais on ne peut pas imaginer son odeur. Pendant le trajet, notre guide nous explique que cet ancien lac reçoit chaque jour 2000 tonnes de déchets de Dakar et que quelques trois mille chiffonniers y sont en charge du tri sélectif, directement au cul des camions. Cette visite est l’une des nombreuses étapes de notre tour du monde de l’économie circulaire, et nous sommes là pour comprendre comment cette organisation informelle, presque mafieuse, permet de valoriser près de 80% des déchets, soit un taux de valorisation très élevé. Plus on s’éloigne de la côte, plus le vent brûlant qui s’engouffre par les fenêtres ouvertes se charge en poussières et en gaz d’échappement, jusqu’à faire disparaître les effluves poissonneuses de l’océan. En s’approchant de la décharge, l’atmosphère s’alourdit de relents menaçants.
« D’une violence inouïe, une odeur putride attaque nos sens et ordonne à notre cerveau de fuir au plus vite ce lieu de désolation. »
A la sortie du taxi, l’air se fait soudain suffoquant. D’une violence inouïe, une odeur putride attaque nos sens et ordonne à notre cerveau de fuir au plus vite ce lieu de désolation. Autour de nous, les gens qui travaillent ici semblent ne rien remarquer. Nous devons nous forcer à ne pas obéir à notre réflexe de survie pour pénétrer dignement sur leur territoire. Au milieu de montagnes de déchets de six mètres de haut, chaque chiffonnier fait son tas, sous le regard du chef de l’association qui gère « officiellement » la décharge. Un tas de cannettes, un tas de plastiques, un tas de piles, un tas de fils de fer… Nous observons ce spectacle dans un état de sidération totale, en essayant de lutter contre l’irrépressible envie de vomir que provoque cette odeur de poubelle restée au soleil… puissance 1000.
Un quart d’heure plus tard, notre odorat semble pourtant vouloir nous offrir un répit, comme si notre corps tout entier s’engageait dans un formidable élan d’adaptation à son environnement. Des questions nous assaillent : quelle est l’espérance de vie de ces gens ? Où est passé le lac ? Dans quel état sont les nappes phréatiques ? Quelles espèces animales peuvent survivre dans ce paysage de cauchemar ? Mais le pire est encore à venir. Plus loin, une épaisse fumée noire s’élève dans le ciel.
Je n’oublierai jamais l’odeur de ce tas de pneus brûlés. Atrocement chimique, elle est surtout indescriptible. Plus tard, Raphaël dira qu’elle est lunaire, tant on ne peut pas imaginer que cette puanteur soit naturelle sur terre. Sournoise, elle me met KO debout en trois inspirations, malgré mes réflexes dérisoires pour protéger mon nez avec mes mains et ma manche. Face à une telle concentration de polluants, de plastiques fondus et de matière organique pourrie, mes sens m’ordonnent de prendre mes jambes à mon cou pour sauver ma peau. Si je la laisse s’imprégner trop longtemps dans mes alvéoles pulmonaires, j’imagine que des clignotants rouges vont s’allumer dans mon cerveau pour m’informer d’un risque élevé de mort imminente. Je savais que l’odorat était lié à notre instinct de survie, mais cette fois-ci il ne s’agit pas d’une simple fuite de gaz, mais d’une énorme claque qui ébranle ma conscience. L’odeur de la décharge de Mbeuss a été créée par les hommes. Elle est le produit de notre société de consommation actuelle qui exige d’acheter et de jeter à un rythme frénétique. Tous les jours, elle fait vivre un enfer aux trois mille Sénégalais qui travaillent dans la décharge. Cette odeur ne doit plus jamais exister.
Les déchets ne devraient d’ailleurs jamais atterrir dans une décharge. Comme on l’entend souvent, un déchet est une ressource au mauvais endroit. Dans une décharge, il pollue l’air, les sols et les nappes phréatiques, il met en péril la diversité des espèces animales et l’équilibre des écosystèmes et il génère une pollution qui a des conséquences dramatiques sur notre santé. Bien utilisé, un déchet peut aussi se transformer en or. Après avoir passé un an et demi à aller à la rencontre de 150 start-ups de l’économie circulaire sur les cinq continents, nous pouvons affirmer que les solutions existent, et elles sont nombreuses. C’est pourquoi nous avons créé en 2017 Circul’R, une entreprise sociale qui vise à construire le premier réseau mondial des start-ups de l’économie circulaire afin d’accélérer la transition vers un nouveau modèle, où rien ne se perd et tout se transforme. A travers des actions de sensibilisation et des initiatives concrètes qui permettent aux grands groupes de mettre en œuvre les solutions existantes, nous nous engageons pour que plus personne ne puisse sentir l’odeur de la décharge de Mbeuss. Jamais.
Jules Coignard, co-fondateur de Circul’R
Propos recueillis par Sonia Buchard
Après un diplôme à la Toulouse Business School, Jules a rejoint Airbus Group pendant 3 ans en France puis au Mexique. Passionné par les océans, il décide en 2015 de s’engager dans la réduction des déchets et part avec Raphaël Masvigner faire un tour du monde à la recherche de solutions pour passer d’un modèle économique linéaire (prendre-consommer-jeter) à une économie circulaire, respectueuse de l’homme et de la planète. A leur retour, les deux acolytes décident de créer Circul’R pour promouvoir l’économie circulaire à travers le monde. Depuis, ils mettent en relation les start-ups innovantes avec les entreprises pour imaginer les solutions de demain.
Cette histoire vous est offerte par TALE ME
Louez vos vêtements de grossesse, d’allaitement ou ceux de votre bébé et de vos enfants : faites-vous plaisir tout en respectant la planète ! Depuis 2014, Tale Me est le premier service de location de vêtements éco-conçus et zéro déchet pour la maternité et les enfants de 0 à 6 ans.
Crédits photo : Jules Coignard
#3 – Gare au harcèlement olfactif

Sur l’échelle de Richter de l’inacceptable au bureau, le collègue qui sent mauvais se situe tout proche du sommet, agrippé à l’avant-dernier barreau, pendant que ses compagnons d’infortune lui hurlent de ne surtout pas bouger pour éviter d’aggraver ses problèmes de sudation déjà océaniques. Semblant avoir été confinées dans le tergal en plein soleil pendant des heures, les aisselles moites de ce Robinson de l’hygiène font penser à des atolls douteux sur lesquels ne soufflerait jamais aucun alizé. Cette nuisance qui pourrait prêter à rire tant qu’on n’y a pas été directement confronté est loin d’être anecdotique. D’après une étude de l’Observatoire de la qualité de vie au bureau datant de 2015, 28 % des salariés éprouvent un sentiment de gêne récurrent au travail en raison des odeurs et 38 % d’entre eux estiment que l’entreprise n’accorde pas assez d’importance à la qualité de l’air ambiant.
Pour résumer la situation, on pourrait convoquer cette publicité des années 1970 pour un savon déodorant qui mettait en scène un homme face à une aisselle paradigmatique, moment d’intense solitude assorti du slogan : « À vue de nez, il est 17 heures. » Avec l’aseptisation liée à la tertiarisation, cette focalisation sur les odeurs est allée en s’accentuant tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, jusqu’à devenir une véritable obsession.
Moment d’intense solitude assorti du slogan :
« À vue de nez, il est 17 heures. »
Aujourd’hui, l’époque se fantasme majoritairement sur le mode de la cérébralité hologrammique, balayant d’un revers de manche tout ce qui pourrait nous rattacher à une lointaine animalité jugée incontrôlable. Au Japon, le harcèlement olfactif a même rejoint la longue liste des agressions de bureau (avec le fait d’obliger ses collègues à boire ou à chanter au karaoké). Ces « délinquants » sont, pour certains d’entre eux, invités à suivre des formations afin de rentrer dans le rang.
Parfois, malheureusement, la situation atteint un point de rupture, comme dans le cas de Richard Clem, un Américain licencié car il ne cessait de péter au travail. À la suite d’une chirurgie gastrique, Richard avait totalement perdu le contrôle de son système digestif et émettait des vents nauséabonds, rendant l’atmosphère aussi irrespirable que Verdun sous le gaz moutarde. À part ça, il faisait paraît-il un super boulot.
Cette anecdote illustre bien toute la complexité d’une problématique qui pourrit parfois en profondeur le climat général. Car le collègue qui sent mauvais n’est pas un, mais multiple. Il peut avoir une haleine de chacal ou les dessous-de-bras de Shrek. Une hygiène douteuse ou des problèmes de santé. Il peut faire de son odeur un instrument de nuisance intentionnelle ou, au contraire, vivre dans l’ignorance du désagrément qu’il provoque. Il peut également, avec une sudation ponctuellement excessive, métaphoriser un climat professionnel irrespirable générateur de stress.
Chaque cas particulier nécessitera donc une réponse adaptée. Pour la stratégie ad hoc, on peut par exemple s’inspirer des recettes proposées par l’ouvrage d’Alexandre Dubarry, Comment dire à un collègue qu’il sent mauvais sous les bras1. Car, si ostraciser le salarié malodorant est une tentation à laquelle il faut impérativement résister, le non-dit reste sans doute la pire des options et vous reviendra immanquablement aux narines, comme un boomerang taillé dans le livarot.
1 – Alexandre Dubarry, Comment dire à un collègue qu’il sent mauvais sous les bras, Paris, Leduc.s, 2012.
Nicolas Santolaria
Extrait du livre Le Syndrome de la chouquette. Ou la tyrannie sucrée de la vie de bureau paru aux éditions Anamosa.
Nicolas Santolaria est journaliste nomade. Chez Anamosa, il est l’auteur de « Dis Siri ». Enquête sur le génie à l’intérieur du smartphone (2016) et de Le syndrome de la chouquette. Ou La tyrannie sucrée de la vie de bureau (2018) qui rassemble des textes issus de sa chronique « Bureau-tics » publiée chaque semaine dans Le Monde. Il est aussi l’auteur des Touriste, regarde où tu poses tes tongs 2015, et de Comment j’ai sous-traité ma vie (2017) chez Allary Editions.
Commander Le Syndrome de la chouquette. Ou la tyrannie sucrée de la vie de bureau